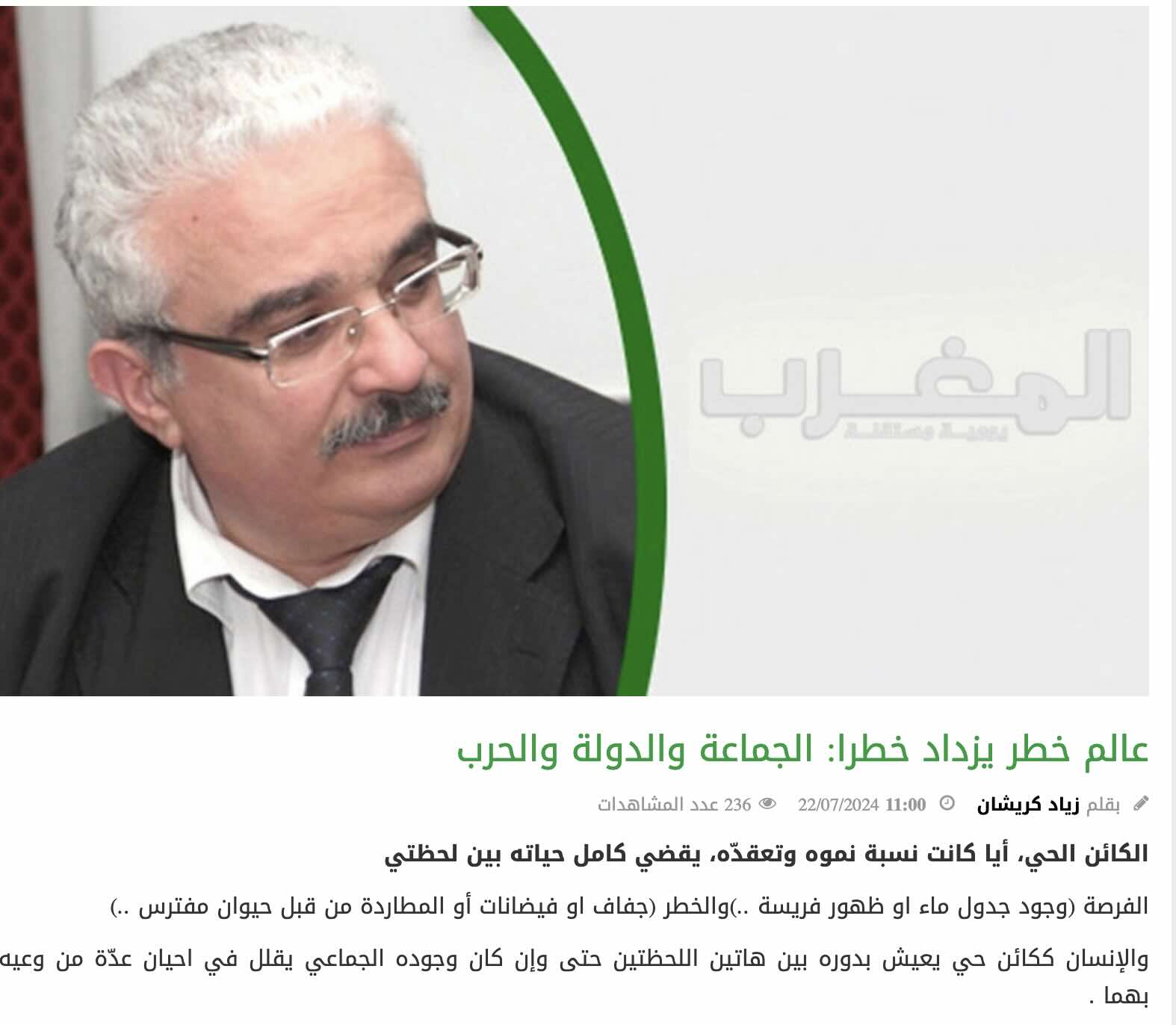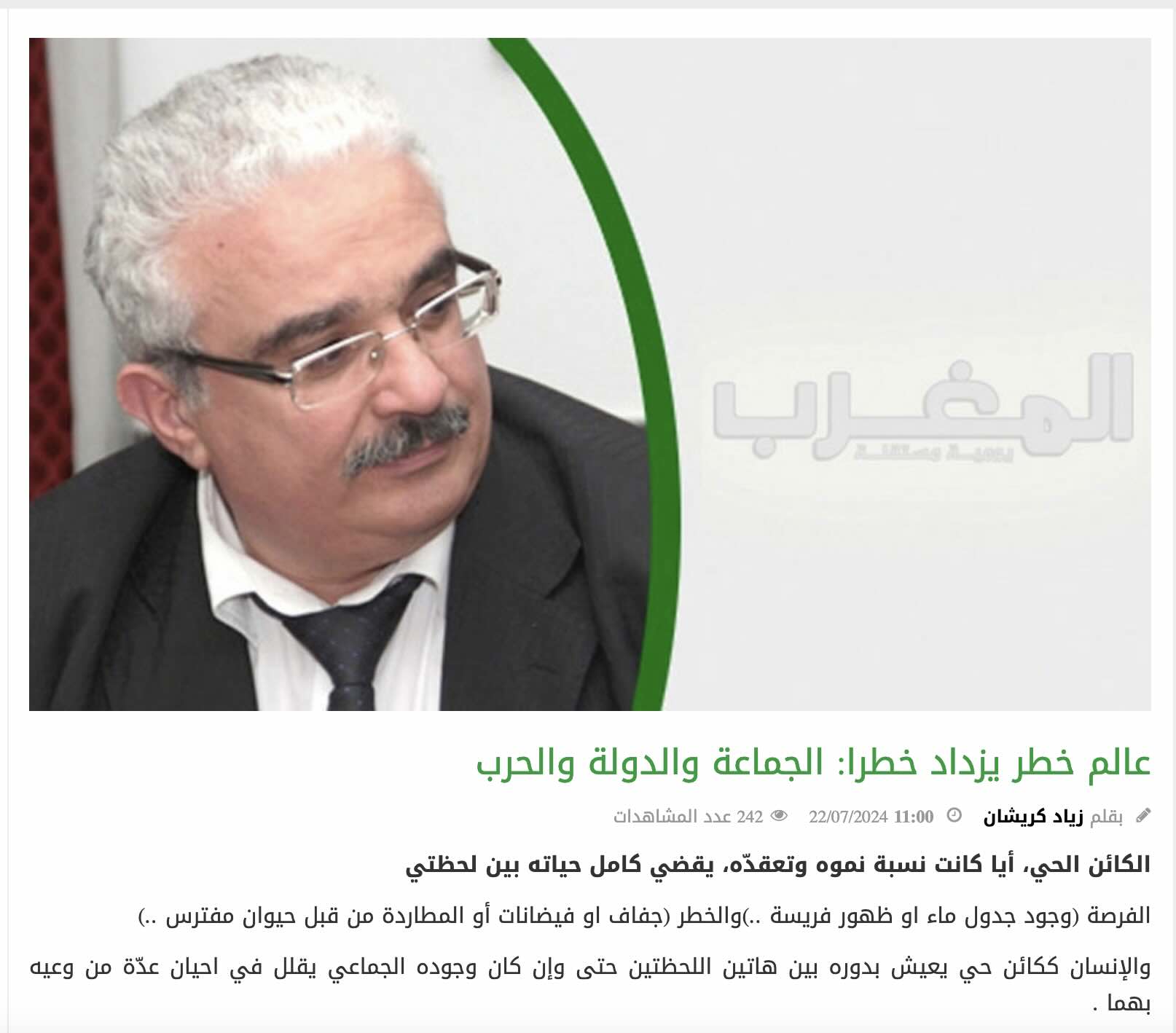Editorial du Maghreb du 23/07 par Zyed Krichenعالم خطر يزداد خطرا: عندما يصبح الإنسان خطرا على الحياة
Cliquer sur la photo pour lire l'éditorial أنقر الصورة لقراءة الإفتتاحية
Editorial suivant الإفتتاحية الموالية
عالم خطر يزداد خطرا : ونحن في كل هذا ؟!
Editorial précédent الإفتتاحية السابقة